Une année d’activités reprend avec ses plaisirs et ses contraintes. Mais Passerelles est un lieu où l’on essaie de faciliter les échanges, de créer des moments conviviaux, des partages d’expériences, des visites culturelles et des lectures nombreuses et diversifiées. C’est un peu votre rôle de choisir des livres qui vous ont plu, dont vous pensez que leur lecture va plaire, enrichir la pensée de vos auditeurs, amorcer des échanges avec notre groupe de lecteurs.
Nous sommes assez nombreux, autour de Louis et Jean je trouve Annick, Monique, Aurore, Noëlle, Ida, Nicole, Isabelle, Marie-Odile, Marie-Christine qui nous rejoint pour la première fois, de même que Annick Hébert (elle nous a demandé de l’accueillir pour tester son adhésion possible) ; et nos fidèles Marie et Marielle. Des absents oui, mais les vacances, les petits enfants à garder, quelques malades…Nous pensons à Nadine, Evelyne, Béatrice, Françoise, Jacqueline, Maryse, Sylvie, Marcel, Eric.
Notre groupe est animé généralement par trois lecteurs passionnés : l’un d’architecture, l’autre de sciences et la troisième de poésie, d’écriture aussi… Vous reconnaissez déjà Sylvie, Louis passionné de Physique et de Biologie et Marcel architecte, pour un temps en congé personnel. Aujourd’hui, Louis assure l’animation de notre Café littéraire.
Rappel d’informations : l’AG s’est tenue samedi 20, le mardi 16 nous sommes allés rejoindre Isabelle pour le Ciné -Passerelles, nous pouvons en parler. Et nous passons aux lectures s’il y a des amateurs pour présenter le livre qu’ils ont choisi. Qui souhaite prendre la parole ?
Louis donne la parole à Isabelle pour présenter le film de mardi dernier « Chroniques d’Haïfa » ou Histoires Palestiniennes. C’est un film de notre temps présent, une famille palestinienne vit en Israël, à Haïfa ; filmé par Scandar Copti, le spectateur assiste à des scènes de la vie de cette famille privilégiée socialement. On pourrait croire que les deux sociétés se ressemblent, costumes, façons de vivre, comportements sociaux, écoles, universités. Et pourtant, dès que se pose une relation tendre entre les jeunes gens des deux sociétés, les réactions parentales sont extrêmes, mots d’ordre sociaux, craintes relationnelles, peur des déclassements, tout l’environnement devient un carcan dont il est difficile de se libérer, sauf peut-être Fifi qui refuse de prendre silencieusement un comportement de respect dans la rue où les passants se sont arrêtés de bouger, fête du souvenir des « six jours », victoire d’Israël. Son frère, lui, a été manipulé par sa famille. Un échange assez long a eu lieu pour retrouver les indices qui permettent de voir plus clair dans ce film complexe. Merci à Isabelle d’animer ce bel atelier.
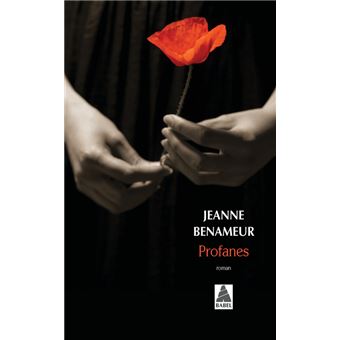
Elle poursuit son intervention par la présentation d’un livre de Jeanne Benameur ; « Profanes », paru en 2013, chez Actes sud. Nous connaissons déjà l’Ecrivaine que Sylvie aime beaucoup. « Vivre tout bas », un beau roman secret et mystique. « La patience des traces »2022, Prix du Roman France Télévisions. Jeanne est née en Algérie, elle enseigne les Lettres, et se consacre à l’écriture qu’elle veut développer par des animations populaires. Le livre choisi par Isabelle « Profanes » date de 2013. Le titre manifeste clairement que de débat sera à tendances philosophique ou spirituelle.
L’intrigue est inattendue : Octave Lassalle a 90 ans, Il a vécu une carrière de responsabilités comme chirurgien cardiaque. Il utilise le biais d’une petite annonce pour se faire un peu connaître et recruter 4 personnes qu’il va spécialiser pour son soutien de nonagénaire, jusqu’à la fin de sa vie. Il souhaite rester dans sa grande maison tenue par une gouvernante qui gère l’ensemble des tâches fondamentales. Il craint que les années qui viennent ne lui fassent connaître la solitude, le silence. Son âge, sa fatigue, son passé l’amènent à vouloir communiquer avec quatre personnes qu’il a choisies méticuleusement. Profane, il espère trouver dans l’humanité même la force de continuer. Il va s’appuyer sur les personnalités de chacun de ses accompagnants :
De 7 h à midi, Marc ; 14h-18h Hélène, philosophe lui fait la lecture ; de 18h à 22heures, le diner, le jardin avec le troisième personnage ; et la nuit une infirmière répond à ses appels.
Cette relation organisée, diversifiée va l’intéresser et peut-être l’aider à sortir d’un doute dont il n’a jamais pu se libérer. En frottant sa pensée à celle des autres, il pense aller bien au-delà de ses propres idées, et trouvera peut-être un nouveau chemin. Isabelle nous dit que ce sujet est original et poétique, sorte de remise en question de soi-même ce qui va le passionner. Le livre est donc une plongée minutieuse dans la vie intérieure de chacun, c’est bouleversant, dit Isabelle. En même temps c’est un hymne à la vie et un plaidoyer pour la seule « foi » qui compte à ses yeux : celle de l’homme dans l’Homme.
Quelques lectures montrent bien la lucidité de cet engagement de la part de Octave pour lui-même et pour ses partenaires qui devraient rester longtemps à ses côtés. Merci à Isabelle pour sa présentation d’un beau livre qui fait réfléchir chacun de nous, sur le temps de retraite, les abandons à surmonter, les retraits prudents ou les audaces fragiles. Cette présentation me fait penser à Montaigne dans « Les Essais », il médite sur la vieillesse, s’entraîne à penser la mort proche comme un stoïcien qu’il s’efforce d’être, plus tard il rejoint une pensée plus douce, plus humaniste, plus relativiste : « J’aime la vie et la cultive ainsi qu’il a plu à Dieu de me la donner. » Et pour cela il a lu tous les grands penseurs de l’Antiquité, il nous les présente, les assimile, mais il faut revenir à l’humilité de l’homme face à son destin précaire. Pardon Isabelle si j’ajoute cette pensée fondamentale de notre culture datée de 1580.>
Louis donne la parole à Marie, elle a beaucoup lu ou relu cet été, sur les conseils de Sylvie « Relire des livres de notre jeunesse et analyser ce que l’on ressent à cette lecture ». Elle a retrouvé « Le nœud de vipère » de François Mauriac, Maria Chapdelaine de Louis Hémon ; (Nicole ajoute à tout hasard Pierre Loti : « Pécheur d’Islande »).
Marie nous rappelle le sujet du roman de F. Mauriac : « Nœud de Vipère » : Un homme est aveuglé par ses passions. Où est l’amour pour son épouse ? D’où vient cette haine si féroce ? Il prend conscience après un récit de sa femme qu’elle a aimé un homme avant lui et que sa famille a caché ce que maintenant il appelle une faute, faute envers lui, faute envers la société et envers Dieu. Le mensonge étant interdit par la religion. Cet homme se sent bafoué et il développe une haine féroce contre son épouse, et contre la société, ses codes et ses mises à l’écart pour des causes privées. Marie est étonnée du pouvoir de la haine qui généralise des comportements, raidit les sentiments. Elle trouve une exception dans le cas de cet homme, il a pleuré la mort de sa fillette de 10 ans. C’est un livre difficile à lire pour la raison de cet entêtement à ne voir que la faute et non le pardon possible.
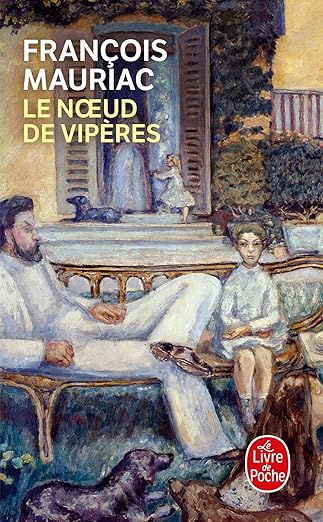
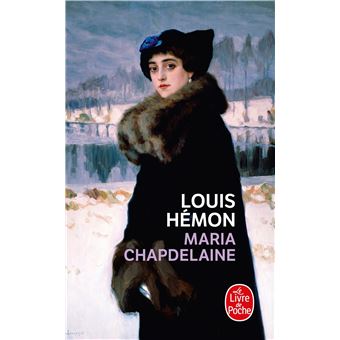
Dans Maria Chapdelaine, la situation est différente : l’action se passe dans les forêts canadiennes, en 1913, l’écrivain se trouve au Québec. Il raconte une tranche vie de Maria, ainée d’une famille de pionniers qui habitaient près du Lac Saint Jean. Elle doit faire son choix entre trois prétendants dont la vie est très différente, l’un est un coureur des bois François, l’autre Lorenzo est parti aux Etats Unis en ville, le troisième Eutrope, son voisin est défricheur comme le père de Maria. Partagée entre la vie en ville une nouveauté, et celle qu’elle connaît déjà dans la forêt, elle ne sait que faire. Le temps passe, pourtant….
Marie constate que la situation des femmes a beaucoup changé puisqu’elles peuvent faire des choix avec plus de liberté. Elle constate aussi que l’amour est peu courant dans ces couples, les conditions sociales sont plus décisives. Une voix dit que les mariages d’amour sont souvent dangereux, il est rare qu’ils correspondent aux critères familiaux, économiques ou sociaux. L’Amour fou est banni de la société bourgeoise. Marie-Odile lit des romans de Balzac, elle fait le même constat.
Chez Laurent Mauvignier : « La maison vide, 2025 » ou « Histoire de la nuit, 2020», »Des hommes, 2009 », les événements sociaux, l’environnement pèsent lourd sur la vie des personnages décrits qui en sortent meurtris à jamais.>
Louis demande à Aurore de nous parler du livre choisi : « La poussière des souvenirs » de Suzanne Abel. Elle est allemande, réalisatrice TV. Elle est née à Kork en 1971, Elle s’est occupée de jeunes enfants comme éducatrice, puis elle a fait ses études à l’Académie Allemande du Cinéma et TV à Berlin, puis elle a travaillé dans l’industrie cinématographique.
La Poussière des souvenirs s’est hissée en tête des ventes dès sa parution en Allemagne.
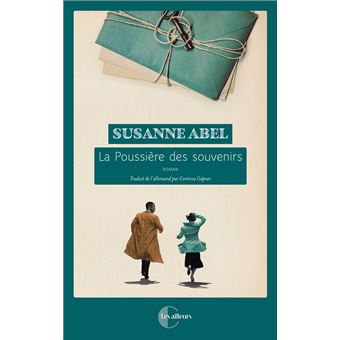
L’héroïne est une dame de 85 ans, Greta, elle vit dans son bel appartement sur les bords du Rhin. Elle perd un peu la mémoire, mais ses souvenirs anciens sont presqu’intacts. Elle raconte ses souvenirs à son fils, son enfance en Prusse orientale, la fuite des soldats russes dans l’hiver glacial, puis la disparition de son Père et sa vie de jeune fille après la guerre. Mais un événement se produit : Une photo de petite fille que son fils ne connaît pas est retrouvée et Greta se tait, se détourne. Tom, son fils enquête sur cette sœur dont il n’a jamais entendu parler.
Que s’est-il passé en réalité ? Avec une tension haletante et une émotion presque continue, l’écrivaine lève le voile sur les « bébés biraciaux » nés de l’occupation. Particulièrement de ceux qui sont métissés ou colorés comme certains GI. La mère de Tom est née en 1932, elle a connu le Nazisme, puis les arrivées de soldats russes et américains. A la fin de la guerre elle a 14 ans. Du côté de l’Armée rouge, les jeunes sont envoyés en Allemagne de l’ouest. Mais l’arrivée à Cologne est difficile, la ville détruite ne permet pas de survivre. Greta est astucieuse elle trouve des expédients, rencontre des militaires qui donne des provisions.
Dans beaucoup de pays occupés par l’Allemagne nazie, il y a eu des viols, des traumatismes que l’on surmonte ou que l’on cache. En Italie, Le sang des innocents, de Dario Argento 2001, me dit-on. Mais le plus pertinent est le livre de Marta Hillers « Une femme à Berlin, 2003 Poche », sur les années 1944-46, puis les reconstructions avec les trois armées d’occupation. « Le troisième homme »1949.
Aurore relève des points forts dans ce livre : *La démence liée à la maladie d’Alzheimer : Greta se met à oublier le quotidien proche et en revanche elle se souvient des souvenirs anciens. Suzanne Bell ne connaissait pas cette maladie qu’elle approfondit dans ce roman, elle parle de « transmission émotionnelle ».
*Le déplacement des habitants de la Prusse orientale qui fuient les armées russes que l’on dit brutales et dangereuses, environ deux millions de citoyens allemands se réfugient en Allemagne de l’Ouest.
*Enfin c’est en 1952, le 12 mars, l’écrivaine entend parler, pour la première fois des « Brown Babies » au Parlement. Ce sont des milliers d’enfants nés de mères allemandes et de soldats noirs américains qui furent arrachés à leur mère, pour être élevés aux Etats Unis par des familles noires. C’est un choix politique et non humaniste. Entre 1950 et1955, près de 68000 enfants illégitimes sont nés, mais on ne s’est intéressé qu’aux 4800 Brown Babies. !>
Merci à Aurore qui choisit le plus souvent des livres rares et inattendus.
Louis donne la parole à Nicole qui va présenter un livre de Ken Follett paru en 2021 : « Pour rien au monde «
L’écrivain anglais jouit d’une grande renommée : il est né à Cardiff en 1949 au Pays de Galles d’Angleterre. Il a suivi des études littéraires jusqu’à une licence de philosophie en 1970, il aime le journalisme pour l’étendue des domaines de l’information et des relations humaines. Puis il se met à écrire des romans policiers et d’espionnage, genre dans lequel il excelle.
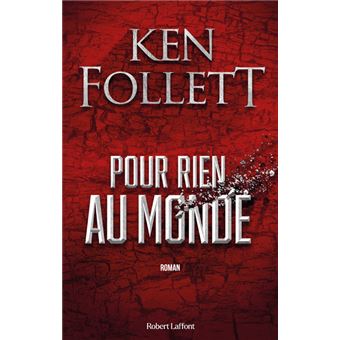
En 1974, il rejoint les éditions Everest books. « L’arme à l’œil » est le plus connu de ses romans, le plus fêté en 1978, il gagne des prix et se vend à plus de 10 millions d’exemplaires. Il vient vivre en France sur la côte d’Azur pendant trois ans, avec sa famille ! Puis il s’installe dans le Surrey et s’engage au Parti Travailliste, il y rencontre la secrétaire du Parti qu’il épouse en secondes noces. Il a déjà deux enfants d’un premier mariage contracté à sa sortie d’études. En 1989, il fait paraître les « Piliers de la Terre », puis « le Monde sans fin »2007, puis « Une colonne de feu »2017. Le premier est un best -seller vendu à 15 Millions d’exemplaires. L’ensemble de sa production représente 170 millions d’exemplaires, dont 7 romans historiques. Nos lectrices et lecteurs connaissent bien cet écrivain.
Il est fait commandeur de l’Ordre de l’Empire Britannique à titre civil en 2018 ; 2019 Officier des Arts et Lettres. Plusieurs doctorats Honoris causa en Lettres.
Le livre à découvrir aujourd’hui fait partie des dernières œuvres, une suite de la série « Le siècle » qui débute sur la période 1900 – 30, une fresque sur les aventures de plusieurs familles, pendant la guerre et la révolution russe. Plus tard, c’est la guerre de 1940 et les dangers qu’elle engendre par ses conséquences.
C’est un conteur exceptionnel, un historien assez fiable, un humaniste surtout, vous pourrez le constater avec ce roman.
L’intrigue du gros livre de 775 pages : K Follett a beaucoup réfléchi et lu sur les guerres et médite une remarque qui le poursuit : « En fait la guerre de 1914 n’était pas voulue par les diverses puissances, alors pourquoi la guerre a-t-elle eu lieu ? » : c’est très intéressant. Il se demande alors : « Est-ce qu’une guerre pourrait avoir lieu actuellement ? nous sommes en 2021. »
Il construit une intrigue possible, des évènements vraisemblables, à travers les pays du monde qui forment des blocs en opposition. Il part de la vie quotidienne des gens qui sont impliqués. Une présidente des Etats Unis, nouvellement élue, dans sa vie quotidienne, sa famille, ses responsabilités, ses adjoints proches et dispersés dans le monde ; un jeune couple de la CIA, qui « parle » à la Présidente, agit dans l’environnement de leur mission, au Tchad, à N’Djamena. C’est un milieu sensible, instable car le Soudan n’est pas loin, il est aux mains des islamistes et autres djihadistes. Les incidents sont relatés avec précision dans un style très visuel : c’est le style « scénario de film » que l’écrivain utilise avec bonheur : on se passionne pour chaque événement qui répond à un plan précis. L’écrivain s’attache à montrer les liens personnels ou professionnels dans les milieux de l’espionnage politique : « A qui l’on parle, devant qui l’on se tait ». Mettre des masques, ou être fidèle, mais jusqu’où ?
Il aborde des aspects de la politique au sein des états de l’extrême orient, Chine et Corée, leurs positions politiques comme nous les abordons actuellement. A partir d’un tableau assez réussi des relations politiques et des informations traitées, on comprend mieux les enjeux des conflits naissants. A quel moment le nucléaire peut-il venir s’imposer cruellement ?
Ken Follett utilise des souvenirs journalistiques pour brosser les détails des conflits qu’il insère dans sa fiction pour la rendre plus vraisemblable. Il s’intéresse aussi bien à un jeune couple en péril, qu’à un groupe de militaires inconscients du péril, une population qui risque l’anéantissement, un porte-avions qui s’effondre dans les flots.
« Pour rien au monde », c’est bien le terme qui repousse une décision horrible, et Ken Follett souhaite nous en prémunir.
J’avoue avoir été passionnée par cet écrivain britannique, j’ai lu deux fois ce gros volume pour mieux apprécier les détails. J’avais lu plusieurs fois les Piliers de la Terre et les suivants qui sont l’expression d’une vision anglaise de la vie des campagnes aux 12ème et 13 ème siècles, la fin de notre Moyen-Age. Ken Follett est un excellent peintre de la société : elle se constitue, devient malade des excès observés, des maux qui la fragilisent. Dans d’autres ouvrages, il est un stratège qui dénoue quelques secrets politiques pour nous les faire comprendre. Et toujours un style concret, simple, efficace qu’il renouvelle en fonction des tableaux à construire comme des vidéos de reportages. Il reste aussi un journaliste pédagogue ! Nos lecteurs aiment cet écrivain prolifique. Et le thème est vraiment proche de nous, de nos peurs.>
Louis redonne la parole à Marie pour qu’elle nous dise quel poème ancien elle a choisi.
Dans un livre édité en 1936, elle a trouvé des Fables de Florian, pleines de bon sens pour éduquer les jeunes élèves à la vie quotidienne :
La guenon et la noix. Les illustrations sont de Benjamin Rabier.
<Une jeune guenon cueillit
Une noix dans sa coque verte ;
Elle y porte la dent, fait la grimace… » Ah ! certes,
Dit-elle, ma mère mentit,
Quand elle m’assura que les noix étaient bonnes ;
Puis croyez aux discours de ces vieilles personnes
Qui trompent la jeunesse ! Au diable soit le fruit ! »
Elle jette la noix ? Un singe la ramasse,
Vite entre deux cailloux la casse,
L’épluche, la mange, et lui dit :
« Votre mère a raison, ma mie,
Les noix ont fort bon goût, il faut les ouvrir.
Souvenez-vous que, dans la vie,
Sans un peu de travail on n’a pas de plaisir. > Florian.
Nous avons tous souri en reconnaissant le texte, véritable leçon de morale ; d’écriture qui montre le rôle de la ponctuation ! le style précis du conte ou de la fable, les raccourcis, la grammaire parfaite. Merci pour revenir aux principes de l’écriture à une époque, la nôtre, où écrire, lire sont de plus en plus rares. En revanche dans quelques années ce seront les robots qui seront les plus cultivés. Merci Marie pour ton talent qui déniche de vraies pépites.
Louis aime François Cheng et nous tous aussi.
Poèmes de François Cheng.
C’est un écrivain, poète et calligraphe français, né en 1929 en Chine. Issu d’une famille de lettrés et d’universitaires, il est naturalisé français en 1971, membre de l’Académie française depuis 2002. Ses travaux se composent de traductions des poètes français en chinois et des poètes chinois en français, d’essais sur la pensée et l’esthétique chinoises, de recueils de poésies, de romans et d’un album de ses propres calligraphies. François Cheng est profondément imprégné à la fois de christianisme et de taoïsme (qui repose sur des concepts tels que le Yin et le Yang, l’harmonie avec la nature, et la simplicité), cela transparait clairement dans sa poésie.
Les deux poèmes sont issus du recueil « La vraie gloire est ici » dans lequel il aborde la quête de sens, la spiritualité. Pour Cheng, la vraie gloire réside dans la capacité à trouver la beauté dans l’instant présent et à simplement célébrer la vie.
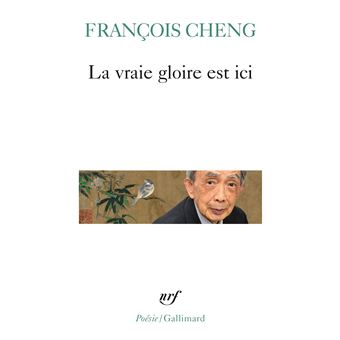
Premier poème
<D’ici là
D’un instant l’autre
L’inattendu adviendra
Quand le divin habitera l’intervalle.
Du dire à l’ouï-dire,
Du don à l’abandon,
Tout le souffle du printemps
Qu’un trait d’éclair retrace.
Les anciens rêves éclatant en bourgeons,
Soif et ivresse demeurent intactes ;
Dans le rythme primordial retrouvé,
Source sera nuage et nuage averse,
D’ici là
D’un instant l’autre
nous nous rejoindrons,
chacun en avant de soi
S’étend de ce qu’il ouvre,
S’accroît de ce qu’il donne,
Toute fêlure offrande,
Toute en-tente
ex-tase.>
Second Poème
<Nous voici dans l’abîme,
Tu en restes l’énigme.
Si tu dis un seul mot,
Et nous serons sauvés.
Tu restes muet encore,
Jusqu’au bout sembles sourd.
Nos cœurs ont trop durci,
En nous l’horreur sans fond.
Viendrait-elle de nous,
Une lueur de douceur ?
Si nous disons un mot,
Et tu seras sauvé.
Nous restons muets encore,
Jusqu’au bout restons sourds.
Te voici dans l’abîme,
Nous en sommes l’énigme.>
Merci Louis.
Merci à vous tous et toutes pour avoir nourri ce café littéraire de vos lectures, vos réflexions, vos sourires, vos échanges. Cela nous permet de vaincre l’ennui ou la solitude, cela nous enrichit, nous donne des objectifs. La prise de parole est importante également, nous pourrions devenir enroué de ne pas assez parler, notre voix pourrait s’érailler par le silence. !!!
Un thé réconfortant et des tranches de cake pourront nous réunir autour de la nappe de pique-nique et de la grande théière. Chacun ressent le plaisir partagé pendant le café littéraire.
Nous serons ensemble lundi 6 octobre, 14 heures, à l’Ermitage.
