Bien que les vacances soient commencées pour le plaisir des familles et des petits-enfants, de nombreuses lectrices aussi, nous étions heureux de nous réunir à l’Ermitage, sous la pluie ! Nous ont rejoints rapidement : Marielle, Maryse, Louis notre animateur présent, Jean, Marie, Régine, Marie-José, Noëlle, Fabienne, Nicole, Béatrice, Nadine, Isabelle. Pour débuter la réunion, nous avons repris une présentation de chacun de nos lecteurs et lectrices fidèles pour informer nos nouvelles adhérentes.
Puis, Louis a demandé quelles étaient les présentations de livres disponibles. C’est Isabelle qui proposa trois livres pour « rattraper » ses lundis d’absence ! Louis n’a pas résisté au plaisir de l’entendre défendre ses lectures.
Un premier livre de Natacha Apanah « La nuit au cœur ». Isabelle est émue et même bouleversée en nous parlant de trois féminicides que nous avons pu suivre dans ces temps derniers. Natacha, l’autrice, est l’une d’elles, elle a pu s’enfuir avant l’acte fatal ; Mauricienne, elle s’est attachée à un homme de 50 années de plus qu’elle. A 17ans, elle a subi l’emprise d’un homme séduit par sa jeunesse. Cette expérience constitue la première partie du livre, elle est bouleversante, nous dit Isabelle. Pour que les deux autres victimes ne soient pas oubliées, Natacha raconte les informations qu’elle a recueillies : l’une était malgache, dans sa famille. Elle a cherché à questionner : Comment en arriver là et comment en sortir ? Etait-ce un comportement d’emprise ou de chantage pour l’homme abusif ?
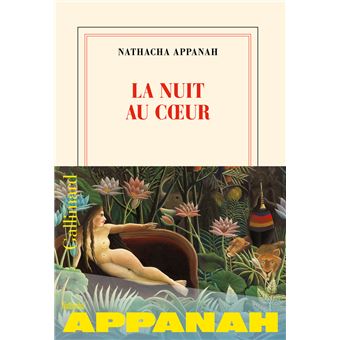
Marie-José avance une hypothèse culturelle, la femme maghrébine est souvent isolée dans sa maison et s’occupe de tâches familiales ; dans les deux cas décrits dans le livre les hommes sont algériens. Or dans l’un des cas, la femme souhaitait faire revenir son fils près d’elle, contre l’avis de son compagnon.
Cela relève de la justice, bien sûr, mais il y a eu deux assassinats violents, inacceptables.
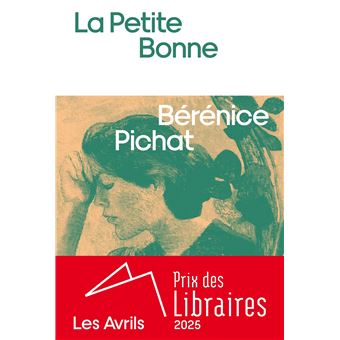
Pour nous changer un peu, « La petite bonne » de Béatrice Pichat, est un livre plus humain. Cela se passe comme un huis clos. L’écrivaine est un Professeur des Ecoles qui reparle des affres de la guerre de 1914-18, les douleurs corporelles, gueules cassées, poumons brûlés par les gaz, membres disparus. Dans un suspense extraordinaire, la jeune bonne qui est employée chez les Daniel, doit rester seule pendant un Week-end avec un homme privé de ses membres inférieurs et dont les mains sont en parties brulées. L’écriture est particulière, les dialogues adultes sont en prose classique et fort bien écrits et les réflexions de la jeune bonne sont exprimées en vers libres. Cela donne au livre une originalité certaine. L’intention de l’écrivaine n’a pas été exprimée, on peut supposer que devant tant de souffrances, la jeune bonne est très émue et les émotions se traduisent de façon poétique, son cœur est ouvert à la douleur de l’autre. Dans ce long temps passé à s’occuper de cette victime, elle s’enrichit aussi, ouverture vers la musique, à la mixité sociale. Chacun des êtres fait un pas vers l’autre.
Le troisième livre, non le moindre, écrit par Laurent Mauvignier « La maison vide » est très récent, 2025, il est présenté aux divers prix littéraires. Nous connaissons déjà Laurent Mauvignier : « Des hommes »2009, qui a beaucoup marqué par la sobriété de la peinture des douleurs traumatiques après la guerre d’Algérie. « Histoire de la nuit »2020. Le volume de plus de 750 pages est riche des souvenirs des habitants de la maison vide maintenant ; la quête commence avant la guerre de 1914, avec l’arrière-Grand-mère, Marie-Ernestine spécialiste des confitures et du repassage des chemises. Dans cette grande maison qui garde des souvenirs, l’écrivain se souvient et retrouve des documents, des photos ; il retrouve une commode centenaire et cherche partout une Légion d’honneur. Il ne s’arrête que vers 1985, au suicide de son père. C’est tout le XXème siècle qui est retracé en plans très larges ; et le lecteur se passionne, se réjouit de ce récit du « temps perdu. » L’auteur ose l’intimité de sa famille dans ce livre qui sera un grand succès, c’est un immense cadeau au lecteur et une audace forte pour ce groupe familial.
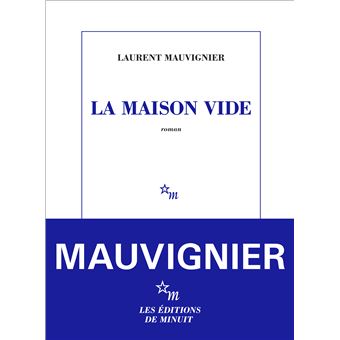
Il imagine les difficultés de ces femmes qui restent seules pour faire « tourner » la ferme ou l’entreprise, alors que les hommes sont partis sur les routes et les champs de batailles. C’est la petite histoire de chaque famille à côté de la grande histoire du Pays. Le style de Laurent Mauvignier est remarquable, Isabelle reconnaît un grand livre et un grand romancier, de la taille de E. Zola avec les Rougon-Macquart. Isabelle ajoute que ce récit montre la place de la femme dans une société encore patriarcale, la violence faite aux femmes dans l’intimité des foyers et celle du pouvoir qui impose aux hommes de ne pas pleurer, partir comme de la chair à canon pour servir des ordres que personne ne comprend. Avec le portrait de cette famille sur trois générations, le roman nous invite à observer la condition des femmes : Marie-Ernestine, qui est une artiste aux ailes brisées, Marguerite la grand’mère qui paiera cher le privilège d’avoir connu l’amour, et au bout de la lignée, le père qui met fin à ses jours.
Isabelle souligne la langue parfaite, la phrase qui devient ample et la précision du vocabulaire, la minutie obsessionnelle dans la description des états d’âme, les couleurs du ciel. Il est nourri de grands écrivains du XIX ème siècle, Zola, Proust, Balzac bien sûr. Il offre au lecteur un plaisir intense et rare.
Jean suggère de lire Henri Barbusse (1873-1935) qui a mis sa vie en danger dans les tranchées, les manœuvres en face de l’ennemi dans Le Feu. Il est tragique dans ses récits et sa noirceur est difficile à supporter. Louis-Ferdinand Céline (1894-1961) a écrit Guerre, paru en 2022 post-mortem, en est proche lui aussi. Nous en avons parlé il y a deux ans avec Mort à Crédit et Voyage au bout de la nuit. Merci à Isabelle pour ces trois livres que nous retrouverons surement dans la presse ces temps prochains.
Puis c’est à Béatrice que Louis donne la parole. Elle a lu « l’Envol » paru en 2023 par Aurélie Valogne. L’autrice est née en 1983 en région parisienne et depuis 2016, elle fait partie des dix auteurs les plus lus ; ont beaucoup plu, « Mémé dans les orties » en 2014 ; « Le tourbillon de la vie »2022. Ses titres sont populaires et les récits sont sympathiques et efficaces.
Béatrice explique l’intrigue : l’émancipation d’une fille par rapport à sa mère protectrice. La composition est intéressante puisqu’elle donne la parole aux deux personnages. Gabrielle est mère célibataire, protectrice de sa fille ; Lili est fusionnelle dans son enfance, puis devenue adolescente, elle cherche à s’émanciper selon l’ évolution sociale : Lili fait des études qui l’entraînent dans la classique évolution décrite par les sociologues Bourdieu et Passeron dans les Héritiers 1964. Peu à peu Lili s’isole dans ses études, les examens à réussir et Gabrielle se sent seule, heureuse des résultats de sa fille, mais « elle n’en demande pas tant ».
Béatrice explique l’intrigue : l’émancipation d’une fille par rapport à sa mère protectrice. La composition est intéressante puisqu’elle donne la parole aux deux personnages. Gabrielle est mère célibataire, protectrice de sa fille ; Lili est fusionnelle dans son enfance, puis devenue adolescente, elle cherche à s’émanciper selon l’ évolution sociale : Lili fait des études qui l’entraînent dans la classique évolution décrite par les sociologues Bourdieu et Passeron dans les Héritiers 1964. Peu à peu Lili s’isole dans ses études, les examens à réussir et Gabrielle se sent seule, heureuse des résultats de sa fille, mais « elle n’en demande pas tant ».
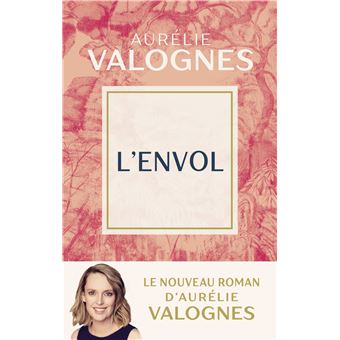
D’autres thèmes paraissent, en particulier l’isolement de Lili qui n’a pas les codes pour changer de groupe social. Ses relations d’étudiante sont parfois décevantes, les paroles échangées sont souvent des griffes ou des attaques qui la dévalorisent, créent des complexes sociaux durables. Cela existe toujours et devient parfois du harcèlement dangereux. Pour ne pas être formatée par sa mère, Lili choisit l’éloignement, mais la solitude maternelle est douloureuse.
Nos amis citent le film « La voie Royale » de Frédéric Mermoud. Le film montre bien, le désir de succès, de vivre et réaliser les rêves, mais le prix en est lourd.
Merci à Béatrice de nous parler avec ce livre de notre passé d’étudiant plus ou moins lointain. Avec le rappel du film La voie royale (qui n’a rien à voir avec le livre de André Malraux), le groupe montre que ces questions sont très présentes dans notre vie sociale actuelle. Et pas seulement chez les adolescents, les parents de ces adolescents sont devenus les « Boomers » !
Louis donne la parole à Marielle, pour une fois nous n’avons d’espace poétique, mais que va nous dire Marielle ?
Marielle toujours présente nous propose un travail personnel entre deux œuvres majeures Un livre de Sylvie Germain « Tobie des marais ». Sylvie Germain née en 1954 est une grande dame de la Philosophie, des lettres en général, elle est romancière, essayiste et dramaturge française. Dans les années 1970, elle suit des études de philosophie auprès de Emmanuel Lévinas. Son mémoire de maîtrise porte sur la notion d’ascèse dans la mystique chrétienne et sa thèse de Doctorat sur le visage humain. Elle publie en 1984 « Le livre des nuits » après un voyage en Tchécoslovaquie et un encouragement de Roger Grenier 1919-2017, journaliste, écrivain. Ce livre majeur reçoit six prix littéraires. Plus tard en 2022, elle fait paraître « La chanson des Mal-aimants » et « Magnus ». Ce dernier reçoit le Goncourt des Lycéens avec un accueil enthousiaste. Puis elle s’engage dans une ONG pour faciliter l’accès au savoir des pays en développement. Elle écrit dans un groupe, un livre collectif : « Scandale » ; puis « Jour de Colère » qui aura une grande influence sur elle. On compte 33 livres publiés par cette grande figure des Lettres.
Tobie des marais 1998, est un livre librement inspiré du récit biblique le Livre de Tobie. L’Histoire se déroule dans le marais poitevin que connaît bien Marielle. La famille de Tobie est poursuivie par une malédiction qui a décimé ses ancêtres. Un jour Tobie en ciré jaune, roule sur son tricycle sous un orage, chassé par le vent du malheur.
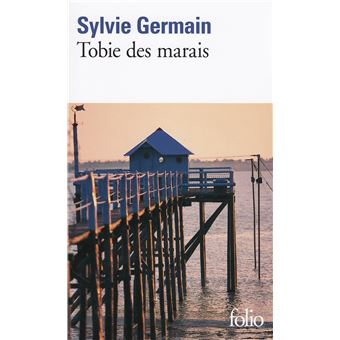
La Grand-mère de Tobie est installée en Marais poitevin depuis son exode de Pologne : c’est Déborah. Plus tard Tobie accompagné par Raphaël, son ami et peut-être protecteur, part en voyage. C’est alors qu’il rencontre un peintre et sa fille Sarra. Tous deux sont victimes d’une malédiction. Aidé par Raphaël, Tobie parviendra à lever la malédiction. On pourrait dire que Sylvie Germain redonne vie à un conte biblique qui traite de la famille au sens large. Le père de Tobie, son frère, sa nièce Sarra, sont tous victimes de malédictions, cécité pour Tobit, le père, des morts de jeunes gens qui s’approchent de Sarra pour l’épouser. En fait Tobie, conseillé par son ami Raphaël, va trouver comment guérir sa famille de ces dangers, grâce au fiel d’un poisson qui faillit le dévorer. Puis il poursuit sa vie sagement en ayant pris Sarra pour « sœur » et épouse.
Les thèmes sont très bibliques, Le merveilleux et le réel ; la mémoire et l’histoire, l’amour et l’amitié ; la mort et la vie. Les recherches de Marielle sont nombreuses, mais particulièrement centrées sur le thème « comment se structure la pensée ? » en fait un regard épistémologique, pas seulement sur le langage (révélateur) mais sur le processus mental concernant la formation d’une idée, d’une action qui s’organise, d’un savoir qui se construit en arborescence ou en jaillissement. Ce sont des mystères à dévoiler, entre le biologique et l’inexpliqué.
Merci à Marielle qui s’applique à ces recherches tout en luttant contre des difficultés de Santé.
Louis prend la parole pour présenter ses recherches littéraires et scientifiques :
*Un mot sur Hervé Bazin et son roman, « Vipère au poing » d’une part :
Le roman paraît en 1948. Il est présenté par son auteur comme autobiographique. Gros succès : 5 millions d’exemplaires vendus. Le livre raconte l’enfance et l’adolescence de l’auteur, en particulier ses rapports avec sa mère indigne et cruelle dite « Folcoche ».
Une imposture littéraire ?
En octobre 2025, le récit de ce roman, de même que de nombreux épisodes de la vie de Hervé Bazin, sont remis en cause par le livre enquête d’Émilie Lanez : « Folcoche », publié chez Grasset.
Selon les recherches de l’autrice, qui a puisé dans différentes archives, familiales, policières, judiciaires et médicales « Vipère au poing » serait une mystification littéraire conçue comme une vengeance contre sa famille et un moyen de faire lever la tutelle sous laquelle il avait été placé en 1937 en raison de ses différentes frasques, et ainsi toucher sa part d’héritage. Le livre aurait été écrit en deux ans à la prison de Clairvaux où l’auteur purge depuis 1942 une peine de quatre ans pour diverses escroqueries. En 1929, à l’âge de 18 ans, Hervé Bazin avait cambriolé la maison parentale avant d’alterner séjours en Psychiatrie et en détention.
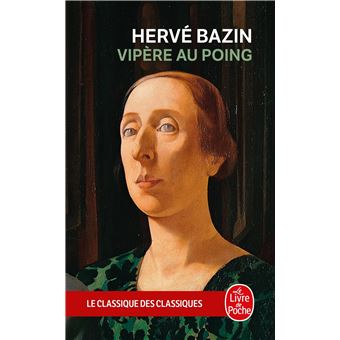
La mère de Hervé Bazin n’a rien de commun avec celle qui est surnommée Folcoche dans le roman. Au moment de la parution du livre, Hervé Bazin confie d’ailleurs dans une lettre à son frère Pierre l’objectif de son livre : « Il faut le dire, j’ai besoin d’un peu de scandale pour hausser la voix et me faire entendre à mon heure, je sais d’avance que la famille va rugir. Aucune importance ! Je me marre à l’idée de gagner de l’argent pour la première fois sur le dos de ma mère. Sa mère, restée muette sur la caricature qu’il a donnée d’elle dans ce roman, mais profondément éprouvée par la parution du livre se réconcilie finalement avec lui en 1954.
- D’autre part : Eliette Abécassis : « Autopsie du contemporain » (2025, chez Hermann)
Eliette Abécassis est une femme de lettres française, normalienne de formation et agrégée de philosophie. Elle est romancière et scénariste. Elle naît en 1969 à Strasbourg dans une famille juive orthodoxe très pratiquante. Son père enseigne la philosophie et est un penseur renommé du judaïsme.
Elle a écrit de nombreux romans, depuis Qumram en 1987, souvent à portée autobiographique, dans lesquels le judaïsme occupe en général une part importante. Elle déclare son attachement à l’universalisme français.
Autopsie du contemporain
Pour la première fois, Eliette Abécassis nous livre un court essai de 175 pages.
Son propos est une réflexion sur un monde actuel qui inquiète. Elle constate que si toutes les époques ont connu des conflits intergénérationnels, peu ont subi des écarts culturels entre générations aussi profonds que les nôtres. Sa génération se vit en décalage avec les « digital native » : les émoticônes remplacent les lettres, les images et les textes. L’univers virtuel émergent est à l’origine d’une humanité nouvelle soumise à l’intelligence artificielle, au big Data et au diktat des GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon).
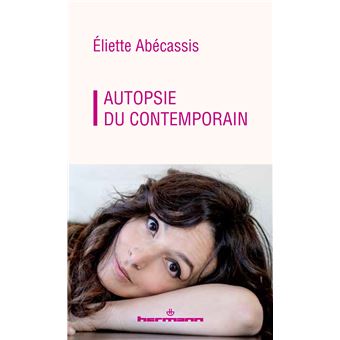
Au-delà de ces écarts culturels, elle observe aussi que le monde contemporain montre une résurgence des fondamentalismes et des guerres, une montée des extrêmes, des dérives populistes, des démocraties en grandes difficultés, au milieu d’une crise climatique et écologique.
Elle ne présente pas un texte difficile d’accès, très théorique et intellectuel habituel pour des Essais. Elle adopte une approche fragmentaire décrivant une multitude de situations concrètes de notre quotidien en courtes séquences de 2 à 3 pages. Toutes sont marquées par notre désorientation face à ce quotidien, jusqu’au plus profond de l’intimité. C’est dans ce quotidien qu’elle décrypte de grandes ruptures. Elle a baptisé son livre « autopsie « car elle a voulu voir, par elle-même et en elle-même, là où l’humanité se fracture. Non seulement pour établir un constat, mais aussi pour trouver des signes d’espoir.
Lecture p. 11-12 (introduction), p. 41-42 (Photos, selfies),
J’ai trouvé cet essai passionnant : il n’a pas l’aridité des textes des sociologues et des économistes, ni la difficulté des textes philosophiques. Elle décrit la vie, de manière simple, avec ces changements qui s’opèrent, qui modifient les comportements et les relations entre les humains et entre les générations.
Elle défend avec passion une transmission de génération en génération par les maîtres et les livres, alors que la transmission se fait aujourd’hui malheureusement préférentiellement de façon horizontale par les réseaux. Son regard est celui d’une femme d’aujourd’hui, et aussi d’une mère qui s’adresse souvent à sa fille. C’est aussi celui d’une femme juive dans la société actuelle française ; elle montre à plusieurs reprises l’énorme difficulté qu’il y a à vivre en France compte tenu de l’antisémitisme ambiant, mais elle est résolument contre l’attitude de Netanyahou et de son gouvernement et sur ce qui se passe dans les territoires palestiniens. Lecture P. 82-83 (sur l’antisémitisme)
Son livre est très éclairant sur les constats et elle livre des analyses fines ; j’en recommande la lecture pour mieux saisir ce qui est en jeu dans le monde actuel.
Enfin, comme dans ses romans, elle nous gratifie d’une magnifique écriture. Merci à Louis pour ce livre court et essentiel pour notre pensée en construction.
********************************************
Heureusement le thé habituel nous attend après ces livres excellents qui nous interrogent sur nos vies, nos passés et les discordances évidentes qui nous assaillent en face de ce qui se présente. Ce moment de détente autour d’un thé devient nécessaire pour échanger avec telle présentatrice ou tel présentateur de romans ou de recherches. Unissons-nous dans nos efforts, pour construire au-delà des discordes parfois utiles, un futur humain, tolérant, pacifique. C’est mon vœu.
Nous nous retrouverons le lundi 3 novembre à 14h.
