Peu à peu nous reprenons l’habitude de nous réunir le lundi après -midi. Nos animateurs sont prêts, avec des idées nouvelles, sujets intéressants. De nombreuses listes de livres tout justes édités pour certains, sont publiées en vue des prix annuels ; Goncourt, Grand Prix de l’Académie Française, Renaudot, Femina, et les prix de romans policiers… Vous les avez vus en librairie ou sur votre smartphone… Autour de nos animateurs, Sylvie et Louis, sont arrivés Marielle, Maryse, Fabienne Lauque, Marie -José, Béatrice, Anne, Nicole, Aurore, Marie-Odile, Monique, Marie, Annick Hébert, Régine Saulière. Plusieurs de nos lectrices sont grippées, nous leur souhaitons meilleure santé.
Sylvie prend contact avec le groupe ; elle avait, en juillet proposé une réflexion sur les livres de notre jeunesse, « Leur accordons-nous des émotions différentes ou des jugements ? Marie s’en souvenait il y a quinze jours ; Marie-Odile revient avec plusieurs livres relus et souhaite nous en parler. Sylvie poursuit avec le thème de la Famille : beaucoup de nouveaux romans de cet automne abordent les thèmes de la Mère ou du Père, comme A. Nothomb, Mauvignier, Bazin, A.Valéry. Puis elle donne la parole à Marie-Odile.
*Little Rock1957 attire Marie-Odile par sa couverture, en noir et blanc, une photo d’un mouvement de Jeunes qui remonte loin dans nos souvenirs. Pour elle c’est un moment important où les jeunes étudiants de cette université s’opposent :
« Little rock 1957 » de Thomas Snégaroff, journaliste, (choix encouragé par Sylvie).
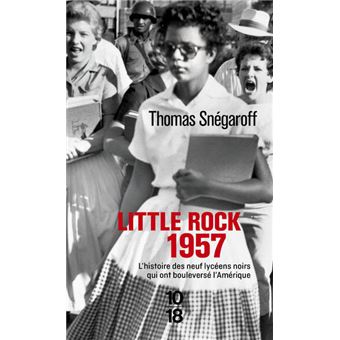
<Un livre toujours d’actualité. L’intolérance, le racisme… sont loin d’avoir disparu!
– En 1957, l’intégration d’élèves de couleur en Arkansas (état du sud), bien que conforme à la loi (cour suprême, décret Brown vs Board of éducation of Topeka), souleva passions et émeutes.
– Pour faire admettre 9 élèves seulement, triés sur le volet (d’un excellent niveau, disciplinés, pas trop noirs… ayant résisté aux multiples tentatives d’intimidation…) il faudra l’intervention de milliers de militaires pour tenter d’éviter les dérapages proches du lynchage pur et simple. (……)
– Des foules de fanatiques se déplacèrent en masse, déterminées à faire capoter le projet… Les événements relayés par la radio et la télévision offrent une documentation fournie. Paul Mac Cartney, alors âgé de13 ans, verra un reportage à Liverpool.>
– L’argumentation était « Égalité mais séparation » mesure qui éviterait tout trouble à l’ordre public. L’égalité des établissements n’existait pas du tout. Il aurait fallu beaucoup trop d’argent pour la réaliser, de même la séparation dans les transports…
– Le but non avoué, maintenir les privilèges issus de l’esclavage : l’argent au profit du « blanc », le seul à être reconnu vraiment « Humain » : Le noir est traité comme une « bête de somme » (malheureusement non gratuite depuis l’abolition de l’esclavage), ou plutôt comme une « bête sauvage »: inéducable, dangereuse, sournoise, perverse… qui ne comprend que les coups… Il peut être enchaîné, torturé… éventuellement mis à mort sans réelles sanctions. Donc, mieux vaut lui rendre l’accès à l’éducation totalement impossible…
On pourrait croire ces idéologies dépassées mais la force, l’argent, les armes… sont des valeurs toujours investies dans bien des pays.
Ce livre rend hommage au courage, à l’intelligence, aux droits de l’homme. Il y a des portraits de très belles personnes : Daisy Bates, Thurgood Marshall, les 9 lycéens, certains pasteurs blancs…
-L’ordre des valeurs est rétabli. La couverture, montre le sérieux d’une des 9, Elisabeth Eckford, (entourée de visage haineux) qui se rend pleine d’espoir et de crainte à son premier jour d’école. Les injures « negro retourne en Afrique, on va te pendre, te tuer » les coups tordus, les provocations, les guet-apens… rien ne leur sera épargné… Les toilettes, la cafétéria (p196) les escaliers… seront les lieux privilégiés utilisés pour les torturer… Provoquer pour les faire exclure.
Daisy Bates : le meurtre de sa mère assassinée par des blancs violeurs, sa maltraitance chez le boucher, son adoption… la création de la ligue de soutien aux personnes de couleur… D. Bates a maintenant sa statue au Capitole avec tous les honneurs…
Lectures : L’avocat Marshall, p 22 23 ; Les pasteurs blancs appelés par Daisy B. ; Les Beatles. Black Bird…
*Sur une suggestion de Sylvie toujours, je vous présente un livre lu et apprécié dans l’enfance et relu récemment. Comparer les impressions de lecture :
« La mère » de Pearl Buck.
Depuis mes 14 ans, j’avais gardé un souvenir assez précis de la vie de cette paysanne chinoise, toujours désignée par le vocable, la Mère. Je l’avais trouvé très triste et sa vie rude tout à fait conforme à la description de la Chine de mon manuel de géographie de l’époque.
La gamine que j’étais redoutait la succession inexorable de ses malheurs. J’étais très en colère vis à vis du mari qui laisse sa femme sans argent et part définitivement ; affligée du sort de la fille aveugle. Je ne comprenais pas l’attitude du fils aîné qui s’arroge, enfant, le rôle de chef de famille…
Ce qui m’avait complètement échappé, c’est la survenue de la révolution et la condamnation à mort du cadet comme communiste. Je n’avais pas compris l’irruption de l’histoire dans ce roman préférant me laisser bercer par l’exotisme du récit : la famille, son mode de vie avec les animaux, les naissances, la belle-mère qui use ses vêtements, d’ensevelissement, les cultures et les récoltes, les agents des propriétaires, les voisines, les dieux qui punissent des fautes…
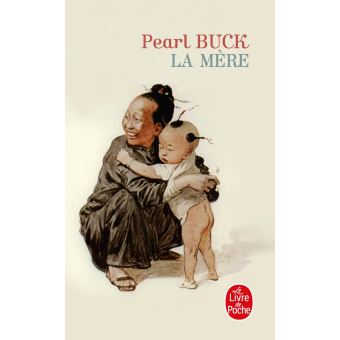
À la relecture, je trouve que la mère se débrouille bien mieux que dans mon souvenir. Bien plus résistante ! Elle agit, ment sur le départ de son mari…
Le récit est une fresque réaliste de la Chine de Pearl Buck. Je nuance bien plus le personnage : face au patriarcat qui rend sa vie difficile, elle lutte opiniâtrement avec ses faibles moyens. Le livre se termine sur une note positive dont je ne me souvenais pas : elle obtient le bonheur de toute mère chinoise : elle a enfin un très beau et vigoureux petit fils…
Beau roman, fluide : Beauté, simplicité, poésie… les personnages sont vivants… voyage réaliste en Chine du fin 19e et début 20e. On voit tout…les images s’imprègnent dans votre cerveau.
Chapeau P. Buck!
Comme dans « 1957 Little Rock », un monde s’effondre, un autre va lui succéder…>
*Troisième livre de ce pot-pourri, « Tant mieux » d’Amélie Nothomb.
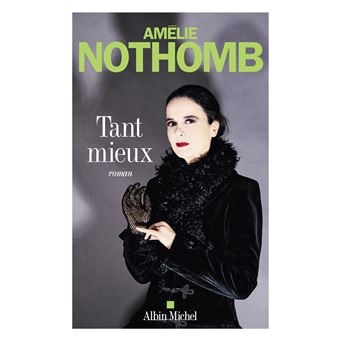
Le lien semblait facile. Ce livre évoquerait une mère, celle de l’auteur. Impossible de passer à côté tant il fut médiatisé… Comme P. Buck, c’est une femme avec une attache asiatique. Je suis sûre que dans 60 ans, ce livre ne me laissera aucun souvenir. !
À. Nothomb dit qu’elle a écrit en prenant la forme d’un conte… J’ai relu pour me mettre dans cet esprit « La tempête » de Shakespeare, et là, j’ai trouvé de l’imagination, de la truculence, de la vie…Je suis plus touchée par les interviews de Mme Nothomb que par ses livres : par l’expression de sa naïveté, une forme de spontanéité… ses livres me semblent froids et squelettiques… Quel contraste après avoir relu « La mère » et « Eugènie Grandet », « La vieille fille », « Le messager »…
L’histoire de ces poupées gigognes, Grand-mère, mère, fille, lue en trois fois rien de temps est une petite infusion… pas toujours plaisante, avec un goût mortifère… mais ce n’est que mon opinion !>
Pour le psy… Merci à Marie-Odile, véhémente dans le débat de ses opinions.
Aurore maintenant souhaite nous faire connaître un très beau volume discret, « Tante Berthe », sensible, écrit par le petit-fils de Paul Valéry (1871- 1945). Grand poète, écrivain, philosophe. Entré au Panthéon en 1945.
Alexandre Valéry, son auteur, souhaite parler de L’Impressionnisme à la fin du XIXème siècle qui modifie la façon de voir le monde ; mouvement très important dans le milieu de la peinture qui chamboule la façon de percevoir la lumière : est-elle composée de « particules » ou est-elle « une onde » question émise par le Physicien Louis de Broglie ? : <certains peintres sont séduits par le concept de particules qui inspirent les audacieux Seurat, Pissarro le pointillisme, le tachisme> ; d’autres sont intéressés par la théorie ondulatoire qui affine les aspects de la lumière, modifie moins les perspectives, donne des vues plus douces ou plus dures selon les ressentis du peintre. La lumière va dominer sur les formes et devenir créatrice de nouveautés : meule de foin éclairée différemment selon les heures de la journée, de même pour les Cathédrales, ou la Sainte Victoire. « Degas dit dans un dîner < l’orangé colore, le vert neutralise, le violet ombre> Valery et Mallarmé participaient à ce moment » Degas est novateur, mais d’autres pensent que les choses sont ce qu’elles sont. !
Le début du XXème travaille les esprits, les mystères de la vision, cela devient une sorte de ‘mystique’ et Paul Valéry est au centre de ces mouvements. Son petit-fils nous rappelle cette époque grâce à des textes du Poète philosophe. « Un impressionniste est un contemplatif dont la méditation est rétinienne : il sent son œil créer et en relève la sensation à la hauteur d’une révélation ».
La mère de Paul Valéry est la sœur de Berthe Morisot qui devient « Tante Berthe », elle reste un peu distante devant ces recherches ; La famille est liée à tout ce monde artistique : elle reçoit Renoir, Degas, Monet, Mallarmé. Ce retour dans le passé est émouvant. Merci à Aurore toujours originale.
C’est maintenant à Anne de nous présenter : « On était des loups » de Sandrine Collette.
Dans une présentation organisée, Béatrice annonce l’écriture particulière du début du roman, le style est haché, les phrases sont longues et sans ponctuation, comme si l’écrivaine souhaitait déstabiliser le lecteur, notre lectrice interprète et suppose que le personnage principal s’exprime dans un langage fruste comme s’il était façonné par la dure nature de sa région ?
Le genre du roman : c’est un drame. Pour Liam frappé par la mort de sa femme attaquée par un animal sauvage pendant son absence, il semble impossible de s’occuper de son fils de cinq ans ARU qui a pu survivre, mais reste témoin apeuré et tremblant sous le corps de sa mère. Le premier sentiment que Liam ressent est la colère, une colère destructive et non la tristesse.
Peu à peu, nous voyons ce père prendre des décisions et partir dans un voyage avec les chevaux et le petit garçon. Chacun essaie de comprendre l’autre, le pays est trop dur pour l’un comme pour l’autre. Que vont ‘ils devenir ? Après de terribles épreuves, cet homme parvient à s’incarner dans sa fonction de père et trouver plus d’humanité.
Les sentiments sont intenses, rage, douleur, haine, amour, abnégation, courage, dépassement de soi. Cela rend le livre fort, humain et vrai, c’est une belle revanche sur le malheur. Il incarne assez bien le cycle du « Voyage du Héros de Joseph Campbell ou Robert Dilts.
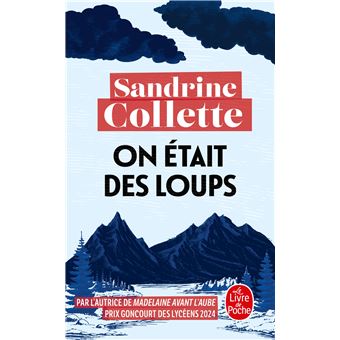
Intérêt de l’ouvrage. La paternité est assez rare dans nos analyses romanesques. La nature est omniprésente et écrasante et l’homme semble se battre avec elle, non pour la détruire mais pour exister en face d’elle.
On sait que les épreuves peuvent faire évoluer les êtres vers des solutions positives mais un basculement des sentiments et des émotions, c’est vraiment difficile. C’est peut-être un combat qui rend l’homme un héros. Un beau livre à lire et à méditer.
Quelques mots sur Sandrine Collette, écrivaine née à Paris en 1970, elle explore le thème de la nature et le genre du roman noir.
Sa formation est classique, bac littéraire, puis master en Psychologie et doctorat en Sciences Politiques. Elle soutient une thèse intitulée « De la loterie nationale à la Française des Jeux ( Contribution à une sociologie de l’Etat moderne).
Elle est chargée de cours à l’Université Paris-Nanterre puis devient chef de Cabinet du président de l’université, puis RH dans un bureau de Conseil. Parallèlement elle restaure des maisons en Champagne et dans le Morvan. Elle décide de composer une fiction : « Des nœuds d’acier » qui obtient le Grand Prix de Littérature Policière 2013. A ce moment elle s’installe dans le Morvan et se consacre à l’écriture.
Ses Six livres sont des succès : En particulier en 2022, Prix Renaudot des Lycéens pour « On était des loups ». En 2024, Prix Goncourt des Lycéens pour « Madeleine avant l’aube ». C’est la qualité d’écriture, la richesse des descriptions des personnages, la palette des émotions, qui font de Sandrine Collette une écrivaine d’exception. Merci beaucoup pour cette riche Présentation de notre amie Anne.
Puis Sylvie suggère une respiration grâce à la poésie. Elle nous propose un moment de Grâce en ayant l’autorisation de lire deux poèmes écrits par la Mère de Phillipe Dordet, époux de notre Présidente, Michèle. Cette jeune femme de 16 ans, Danièle Dordet gagne un concours mettant en valeur ses dons artistiques : Nous avons aimé la subtilité de deux poèmes « Ne dis rien » et « Un quai » (de train), extraits de ‘Séparations’. Merci à Sylvie.
Le temps de respirer, Sylvie donne la parole à Louis qui nous présente un gros livre qu’il a beaucoup apprécié.
« Le dieu des bois », de Liz MOORE. Il s’agit d’un roman sorti en juin 2025 chez Buchet-Chastel.
L’auteure :
Liz Moore est née en 1983 aux Etats-Unis ; elle est romancière, scénariste et également productrice, et en même temps professeure d’anglais à l’Université Temple à Philadelphie où elle dirige le programme de maîtrise en écriture créative. Après une brève période en tant que musicienne à New York, Liz Moore s’est concentrée sur l’écriture. Elle a reçu le Prix de Littérature de Rome 2015.
Le Dieu des bois Le Dieu des bois est son cinquième roman, publié en 2024 aux USA. Un gros roman de plus de 500 pages. Les premiers romans de Liz Moore ont été très remarqués, « La rivière des disparues » a d’ailleurs fait l’objet d’une série télévisée. Mais « Le dieu des bois » est devenu un best-seller aux Etats-Unis (plus de 800 000 exemplaires à ce jour) et traduit dans 25 langues.
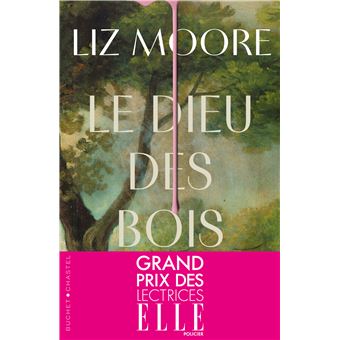
L’intrigue
Il s’agit d’un roman policier à suspense, au sujet d’une disparition d’une jeune fille dans un camp de vacances.
Dans une partie des monts Adirondacks, situés au Nord de l’Etat de New-York, une riche famille (les Van Laar) a acquis un vaste ensemble de terres boisées. Elle y a établi une maison de vacances somptueuse pour la famille et une colonie de vacances pour adolescents, le camp Emerson. Ce camp a pour vocation de leur apprendre à survivre dans les bois, en sécurité. Une règle d’or : « si vous vous perdez, asseyez-vous et criez ! » Pas trop rassurant quand même…Ces bois créent d’ailleurs une sensation permanente d’oppression, voire d’hostilité.
Le roman débute brutalement : une monitrice, Louise, découvre la disparition d’une adolescente du camp ; il s’agit de Barbara Van Laar, la seule héritière des propriétaires. Un retour sur les mois qui ont précédé cette disparition permet d’introduire les personnages principaux : Barbara bien sûr, Louise la monitrice, Alice, mère de Barbara et Peter le père qui forment un couple assez curieux, le grand-père Van Laar très énigmatique et secret, le fils des Van Laar, Bear, qui s’était lui aussi évanoui dans la nature après une sortie en forêt avec son grand-père, quinze ans plus tôt. Il faut aussi ajouter les enquêteurs, Judyta en particulier, qui essaiera de dénouer cette intrigue avec beaucoup d’humanité et d’opiniâtreté.
Lecture p. 17 : découverte de la disparition de Barbara par la monitrice Louise
Lecture p. 60 : début de la recherche de Barbara.
Lecture p. 112 : climat familial dans le couple Alice – Peter, les parents de Barbara et de Bear.
L’enquête se déroule en promenant le lecteur entre le passé et le présent, et aussi selon le point de vue des divers personnages, avec une habileté qui nous tient en haleine tout au long du livre. On va de découvertes en fausses pistes avec une tension permanente qui donne l’impression qu’on ne parviendra jamais à la vérité, ni pour Barbara, ni pour Bear. Mais grâce aux efforts de Judyta, pourtant peu expérimentée mais dotée de bonnes intuitions, l’enquête va finir par aboutir révéler les dessous de ces deux disparitions.
J’ai beaucoup aimé ce roman, d’’abord par la complexité d’une histoire familiale peu ordinaire, et par la psychologie fouillée des personnages. En suite par la technique du récit qui permet de construire petit à petit un puzzle dont on ne voit pas vraiment comment vont s’assembler les pièces. Il faut attendre la toute fin pour avoir la vérité sur ce qui s’est passé, à la fois pour le petit garçon, Bear et pour sa sœur Barbara. C’est un excellent roman policier avec un suspense qui ne faiblit jamais. De plus, au-delà des disparitions, des mystères et des secrets familiaux, le roman inclut une description sociale très intéressante : celle des bourgeois aisés que sont la famille Van Laar et leurs amis, et de tous ceux qui sont à leur service, avec les tensions sociales que cela comporte. Mais aussi à propos des relations parents –enfants et de l’éducation. Enfin je le trouve remarquablement bien écrit, sans cela point de succès d’ailleurs. Un bon moment de lecture pour ceux qui voudront s’immerger dans les Adirondacks !
Merci à Louis, Sylvie reprend la parole pour nous parler de Jeanne Benameur qu’elle nous a appris à connaître depuis plusieurs mois.
Jeanne BENAMEUR : autrice de « CEUX QUI PARTENT » 2019.
On ne présente plus Jeanne BENAMEUR, qui vit sur la côte Atlantique et qui consacre l’essentiel de son temps à l’écriture. Rappelons juste qu’elle est née en Algérie d’un père tunisien et d’une mère italienne. La dernière de cinq enfants et qu’elle a cinq ans et demi lorsqu’elle quitte l’Algérie en raison des violences liées à la guerre d’Algérie et qu’elle arrive à La Rochelle.
L’exil, elle connaît, bercée dans ses deux langues, l’arabe de son père et le français.
Lorsqu’elle écrit, elle ne pense pas au lecteur. Elle a besoin que ce qu’elle écrit sonne juste, car c’est elle la lectrice. C’est le désir de se transformer qui fait sa profonde nécessite d’écriture. L’écriture, dit-elle lui permet d’ouvrir d’autres espaces à l’intérieur d’elle-même et de voir le monde autrement, et encore et encore autrement même si c’est sur le même thème. Ecrire lui permet d’ouvrir de nouveaux horizons et dans ses romans la relation à l’autre est au fondement même de la narration.
Passionnée par la psychanalyse elle dit :
« Mon pari est que si je suis transformée, mon texte transformera d’autres lecteurs, puisqu’on est semblables ».
La psychanalyse lui a permis de mettre en forme par la parole ses émotions et donc de les travailler dans l’écriture. Elle lui a permis de faire le lien avec le partageable. Ainsi elle a cessé de se considérer comme un être original car nous sommes tous régis par une naissance, une mort, une sexuation, nous possédons les mêmes sens pour appréhender le monde… Tous ces éléments font de nous des semblables, même si nous avons nos singularités, notre histoire, notre éducation, notre culture…
CEUX QUI PARTENT (2019) Actes Sud (notes de Sylvie)
Isabelle vous a parlé de Profanes (2013) où le personnage principal Octave, âgé de 90 ans trouve dans l’humanité la force de continuer en s’appuyant sur les personnalités de chacun de ses accompagnants.
Aujourd’hui, je continuerai à mettre en lumière par ce livre « CEUX QUI PARTENT » (écrit en 2019) l’hymne à la vie de Jeanne BENAMEUR et son plaidoyer pour la foi de l’homme dans l’homme.
Revenant à son propre exil enfant, à son parcours analytique entre deux pays, à ses deux langues, Jeanne BENAMEUR se penche sur ceux qui tentent l’aventure de L’AILLEURS :
Elle leur dédie ce livre : « À CEUX DES MIENS QUE JE N’AI PAS CONNUS QUI ONT OSÉ UN JOUR LE DÉPART ET DANS LES PAS DE QUI JE MARCHE »
Durant une journée et une nuit en 1910 à Ellis Island, nous allons suivre leur attente aux portes de New York. Bloqués avant de passer les contrôles sanitaires et de sécurité, avant d’être acceptés ou refoulés. Dans ce moment suspendu, comment s’inventent-ils, les fondations de leur nouvelle vie ? Avec quels bagages arrivent-ils ? Les valises mais aussi leur passé, leur souffrance, ce qu’ils ont voulu fuir…
Dans ce moment de flottement entre le monde d’avant et le monde d’après plusieurs destins se croisent :
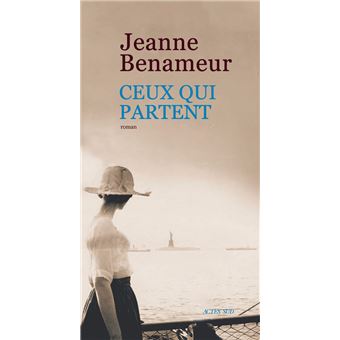
Il y a Donato et sa fille Emilia, les lettrés italiens qui ont choisi l’exil pour survivre à un deuil, Gabor le gitan, qui veut fuir avec son clan la persécution en Europe, Marucca à la voix d’or, gitane de la lignée des Oiseaux qui aime Gabor en secret, Esther l’Arménienne stigmatisée par le massacre des siens, et Andrew Johnson le New-Yorkais, américain de la seconde génération, qui tente par le biais de ses photographies de capter ce qui le relierait à ses ancêtres, émigrants eux aussi.
J’aime décidément l’écriture de Jeanne BENAMEUR, sensible et poétique, tout en finesse et en profondeur, j’aime qu’elle m’entraîne vers les autres et que je puisse me reconnaître, j’aime que les mains se joignent, se caressent.
J’aime être réconfortée dans l’idée que l’on peut se construire tel qu’on est dans le bonheur d’être ensemble.
- Lecture page 54
J’aime retrouver mon émotion dans le chant du violon. Cette voix qui nous traverse le cœur, qui nous met l’âme à nu. « Le violon dit que le désir est tout. Et qu’avec le désir on peut vivre.
- Lecture page 66
Plus que jamais nous devons être conscients d’être semblables, unis dans cette même HUMANITÉ. Nous sommes ces enfants rêveurs, choyés ou meurtris, dans l’apprentissage, les yeux rivés sur ceux des parents, puis lâchés, obligés d’arpenter le chemin de la vie en y semant des petits cailloux…
Qui connaît la chanson des petits cailloux ?
- Lecture page 225
Plus que jamais, ce livre nous ouvre les yeux sur la difficulté du départ, entre le déchirement, la peur et un formidable espoir.
Arrêtons-nous au sens de l’EMIGRATION : ce mot si lourd, si polémique de nos jours…
Posons-nous un moment. Sans vouloir donner de solutions ni rentrer dans le débat. Écoutons simplement Donato lire l‘ENEIDE dans une langue que personne ne comprend sur le bateau, Donato qui veut protéger sa fille Emilia, Emilia qui veut protéger Esther, Écoutons Gabor et son violon, Gabor qui découvre l’amour, écoutons Marucca, l’héritière des chants de ses aïeux, veillée par son père, protégée par son clan.
Peu partent seuls. Et laissons les derniers mots de cette histoire à Jeanne BENAMEUR.
- Lecture page 326.
Merci à toi Sylvie pour ces poèmes et les écrivains qui t’enrichissent et que tu nous fais connaître.
Nous avons bien gagné le thé délicieux préparé et les biscuits apportés. Tous nous allons vers le buffet proposé.
*********************************
Les projets, les informations : Ciné-Passerelles à l’Utopia vous emporte une fois encore vers l’Iran, vendredi 10 octobre.
Le 11 octobre : Déambulation dans le parc du Château Lescombe, à 14h.
« La fresque du Numérique » présentée par Jean-Jacques est un grand moment passionnant.
Louis a suggéré de proposer de voir le film « L’adolescence » sur Netflix dans les jours qui viennent, il sera un objet pédagogique visible dans les établissements scolaires. Je vous propose de le voir chez moi. Cf plus bas, adresse. Plusieurs lectrices sont intéressées dont Aurore que vous pouvez contacter.
Nous nous retrouverons le lundi 20 octobre pour un nouveau café littéraire à 14h. Si vous ne pouvez pas venir participer, ayez la gentillesse de prévenir sur le site de Passerelles ou l’un des animateurs par mail.
Très amicalement, Nicole.
